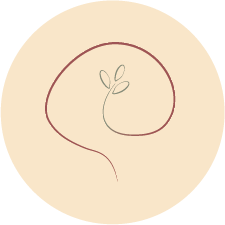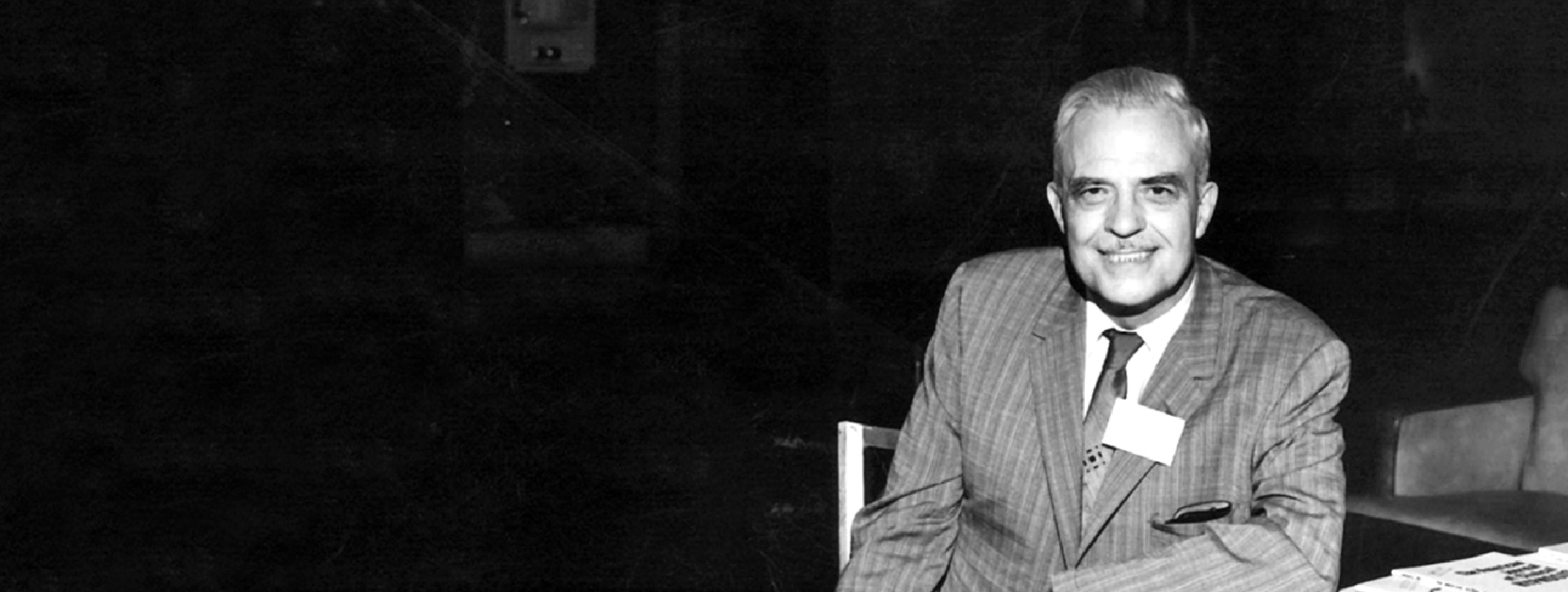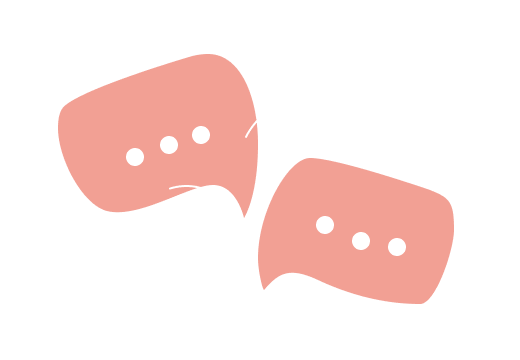Définition
Selon Jean Godin, pionnier de l’hypnose Eriksonienne en France et fondateur de l’Association de Nouvelle Hypnose Française, » l’hypnose est un mode de fonctionnement psychologique dans lequel un sujet, grâce à l’intervention d’une autre personne, parvient à faire abstraction de la réalité environnante, tout en restant en relation avec l’accompagnateur. Cet état de conscience modifié fait apparaitre des possibilités nouvelles, d’actions de l’esprit sur le corps ou de travail psychologique à un niveau inconscient. »
Apparition
Si, d’une certaine manière, la transe hypnotique a toujours existé au travers de différents rites à travers le monde et au cours des civilisations qui nous ont précédé, elle va apparaitre telle que nous la connaissons aujourd’hui, sous une dimension plus scientifique, au cours du XVIII ème siècle. Enfin…pas exactement telle que nous la connaissons aujourd’hui. Car depuis, elle a quand même connu quelques péripéties.
Évolution
L’hypnose a d’abord connu une dimension plus « médicale » et vécu ses premières heures de gloire grâce, entre autres, à Franz-Anton Mesmer (avec un seul S !), le Marquis Armand Marie Jacques de Chastenet de Puységur, l’Abbé José Custòdio de Faria, James Braid, Auguste Liébault, Hippolyte Bernheim, Jean Martin Charcot, Joseph Delboeuf, Pierre Janet…
Puis Sigmund Freud, qui après l’avoir expérimenté un temps, a fini par la condamner. Il s’en est suivi pour l’hypnose un déclin et une période de disette.
C’est dans les années 1930, qu’un psychiatre américain, Milton Hyland Erickson (cf. photo), va lui donner un nouvel essor, la rendant moins « autoritaire ». En apparence du moins. Car si sa pratique de l’hypnose était plus permissive et utilisationnelle que celle pratiquée par ses prédécesseurs, il n’en restait pas moins particulièrement directif quant à l’objectif de la thérapie et les moyens de l’atteindre, sans réellement se soucier de l’environnement de son patient. C’était ceci dit, une attitude assez générale dans la manière de soigner à l’époque.
Heureusement, la façon de concevoir le soin et la thérapie, a évolué au cours du XX ème siècle puis des premières décennies du XXI ème siècle. Les connaissances se sont enrichies, les approches se sont modifiées. L’hypnose Ericksonienne s’est alors peu à peu transformée, étoffée, réinventée. Elle va entrer dans une dimension plus « thérapeutique ». Pour trancher avec la pratique très directive de Milton H. Erickson, et intégrer les nouvelles inspirations qui font de l’hypnose ce qu’elle est aujourd’hui, Daniel Aaroz, sexologue américain, va proposer le terme de « nouvelle hypnose », Corydon Hammond, psychologue américain, celui « d’hypnose intégrative ». D’autres noms vont également émerger.
Aujourd’hui
Quel que soit son nom, d’une manière générale, l’hypnose actuelle s’appuie sur les bases de l’hypnose Ericksonienne, mais enrichie par l’inspiration de nombreuses autres pratiques thérapeutiques et se veut plus intégrative, remettant l’individu au centre de sa propre thérapie, en considérant son environnement familial, professionnel, émotionnel, ses objectifs, ses besoins, ses croyances, ses limites, etc.
Pour conclure je dirais qu’aujourd’hui il existe autant de façon de pratiquer l’hypnothérapie qu’il y a d’hypnothérapeutes. Nous sommes chacune et chacun emprunts des nos sensibilités propres, de celles de nos formateurs, de nos rencontres, de nos expériences…